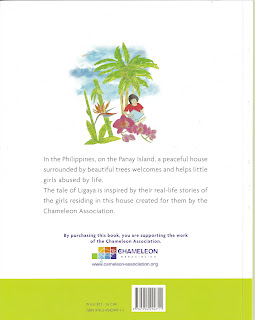lundi 12 novembre 2012
En cohérence avec les objectifs de ce blog qui est un objectif de dialogue, je me suis inscrit sur facebook en souhaitant que ce soit aussi un espace de rencontre entre auteurs et lecteurs et aussi entre auteurs… Dans l'attente de vous lire …
ACTUALITÉ
Après avoir été parrain du salon d'Hermillon les 13 et 14 octobre, présent à Albertville le 27 octobre et à Voiron le 28 octobre, je participerai les 24 et 25 novembre au salon Livres en Marches (Les Marches 73.)
dimanche 11 novembre 2012
LA MAISON DES CAMÉLÉONS(Nouvelle)
Une analyse du livre par Franck Michel, anthropologue.
Avec
son bel habillage, tout en bambous vert pastel, le minuscule ouvrage s’ouvre
par une citation de Camus – « vivre,
c’est ne pas se résigner » – qui révèle tout ou en tout cas dit
d’emblée l’essentiel. Disons-le tout net : s’il est une nouvelle qui
devrait arriver sur toutes les bonnes tables c’est bien celle-là. En non pas
ces mauvaises nouvelles qui minent sans arrêt notre quotidien, en grande
partie, de nantis (il est toujours bon de le rappeler). Cette singulière Maison des Caméléons, joliment bâtie
dans l’imaginaire fécond d’un promeneur-poète, devenu (sans doute un peu malgré
lui tellement l’écrivain est humble et modeste) le spécialiste du massif des
Aravis, est un grand texte sous petit format, une petite nouvelle qui compose
souvent le sel des longs récits, un peu comme le modeste cours d’eau qui en
aval donnera un immense fleuve. La rivière ici mise en mots est tranquille, à
la fois tragique et traumatique, mais toujours heureuse. Car la vie mérite
d’être vécue ce que l’auteur s’attelle si bien à démontrer. Ce petit ouvrage au
grand cœur a été écrit en soutien à l’association Caméléon, créée en 1997 par Laurence Ligier sur l’île de Panay aux
Philippines, et dont l’objet consiste à combattre la maltraitance et
l’exploitation des enfants – notamment des filles – dans l’île. Les enfants
sont recueillis et choyés dans des « maisons » où le maître mot est
la chaleur humaine. La Maison des
Caméléons n’est donc pas qu’une belle nouvelle mais surtout une expérience
concrète qui porte de beaux fruits. Les deux si bien réunis se complètent
admirablement.
L’aventure
se déroule aux Philippines, dans une île perdue de cet archipel lui aussi perdu
– et historiquement si souvent « vendu » à d’autres – au bout du
monde. Même si la nouvelle commence et s’achève avec les papillons, ce sont deux
jeunes filles, au destin dramatique, Karen et sa petite sœur Joy, qui sont les principales
héroïnes de l’histoire. Même abandonnées sur « la montagne fumante », voici des héroïnes pour une fois pas
anonymes de la tragédie de la mondialisation où les plus pauvres
s’appauvrissent et les plus riches s’enrichissent. On connaît la chanson. Ce
n’est pas une raison pour s’y résigner. Camus l’a souligné d’entrée de jeu,
Bogey le confirme dans toute la nouvelle. La « rencontre » impromptue avec Charles, enfoui
dans les immondices, change la vie, leur vie, celle des filles et celle de
l’homme. Une rencontre qui se mue en amitié véritable au fil de sa
construction. La reconstruction des petits êtres broyés par la vie peut alors
également avoir lieu. En d’autres lieux. A l’écart de du bruit et de l’odeur
des poubelles… Dans la « vraie » Maison
des Caméléons par exemple. L’humanitaire
rencontre ici l’humanisme (et le travail social rencontre aussi le travail
d’écriture). Une très belle rencontre pas si souvent opérée dans ce qui reste
fréquemment un business de la bonne
conscience occidentale. Les blessures de la vie et les morsures du monde
empêchent trop souvent nos univers communs mais tellement distincts de se
croiser. Et puis se croiser n’aboutit pas nécessairement à la rencontre, les
Croisades par exemple en témoignent. Survivre sur une monstrueuse décharge à
ciel ouvert n’est pas une vie pour deux filles de 10 et 15 ans, d’autant plus
qu’elles sont abusées – sexuellement et psychiquement – par leurs frères, leurs
pères, et parfois aussi leurs pairs… (puis, pour d’autres, de l’être par leurs
maris). Le monde des hommes peut être effrayant. On le sait, mais on ne fait
guère de ramdam pour lutter contre. Au Pakistan ou en Afghanistan, des jeunes
filles luttent courageusement, contre une société talibanisée et pour le droit
à l’école, au péril de leur vie ; aux Philippines, la situation est certes
moins caricaturale, mais le silence des médias et les tabous culturels
n’arrangent pas les choses et encore moins la vie des enfants maltraités… Cela
dit, la fatalité n’a pas sa place pour les gens qui décident de vivre debout,
ni pour ces deux filles décrites par l’auteur qui arriveront – en dépit de tout
– à lutter, ni pour les membres dévoués des associations qui, comme ceux de
Caméléon, œuvrent – ici comme ailleurs – pour un meilleur vivre-ensemble et
davantage de solidarité. Dans la nouvelles, un homme retrouvé, quasi
ressuscité, ça change aussi la vie, surtout dans un pays gangrené par un
christianisme omniprésent et parfois dogmatique. Mais l’esprit – sain toujours,
Saint pourquoi pas – peut s’ouvrir à toutes et à tous, toutes confessions et
chapelles confondues. Le passage sur « la
prière » est à ce titre intéressant : Karen s’interroge sur sa
foi et, par l’échange avec d’autres cultures et le respect mutuel de tous, elle
parvient à accepter la différence. S’ouvrir à l’Autre en refusant de le voir
comme un autre Moi. Ainsi, lorsqu’elle entend Charles lui dire que « plus on sait et moins on croit ».
Elle reçoit le message, le trouve évidemment bien étrange, mais elle décidera,
un jour peut-être, d’aller creuser ce qui s’y cache derrière… Auparavant, au
début de la relation entre la jeune philippine désoeuvrée et l’humanitaire
français venu à sa rencontre, le climat était certainement plus tendu, la
confiance prend du temps à s’instaurer, rien d’étonnant donc, surtout pour une
fille qui se méfie terriblement – et pour cause – des hommes qui viennent
l’accoster pour la posséder. Karen avait par exemple répondu à un marchand d’êtres
humains qui passait « comme par hasard » dans la décharge :
« Je ne veux rien de toi ! Ce
n’est pas parce qu’on vit dans une poubelle qu’on est des déchets.
Laisse-nous ! ». En agissant ainsi, l’avenir n’est pas
totalement bouché et l’espoir vit, il y a incontestablement de la bonne graine
de rebelle chez cette jeune fille ! Son « cahier », qui fait suite à celui de Charles, raconte son
histoire, son parcours de combattante et non seulement de victime. Charles
aussi s’interroge sur sa « propre » présence sur ce tas
d’ordures ; lui, il sait qu’il peut quitter ce « trou infect » quand il veut, il est libre. Alors, il
culpabilise. Un peu, beaucoup, à la folie, c’est selon, cela dépend toujours du
vécu personnel et de la philosophie de chacun d’entre eux, de chacun d’entre
nous. Bogey nous fait passer par l’écrit, du particulier à l’universel. Et Charles,
s’apprêtant à rédiger un bouquin qui relate son expérience sur place, dit, sous
la plume de Georges Bogey (qui se dévoile sans doute un peu en sa personne) :
« je ne suis pas venu ici pour
mettre en scène le malheur du monde et en faire un spectacle. Je ferai tout
pour que mon livre (qui n’est pas encore écrit !) ne soit ni la
consolation des braves gens ni la jubilation des voyeuristes mais une incitation
à bouger et à faire bouger les choses. J’aimerais tant que les lecteurs, après
avoir lu ce livre, partent sur les chemins défoncés pour réparer le monde déglingué
même s’ils ne savent pas par quel bout commencer. C’est ce type d’ouvrage que
je dois écrire sinon rien. A ceux qui, narquois ou éplorés, me disent que je
veux déplacer les montagnes, je réponds que, si tout homme de bonne volonté
déplaçait une ou deux poignées de cailloux, les sommets de la misère auraient
du souci à se faire ». Ce
très beau passage de la nouvelle est riche d’enseignements. Emouvant. A l’image
de tout ce modeste et grand livre.
Butinant
par mots, monts et vaux, Georges Bogey nous livre ici une ode à la vie, pétrie
d’humanisme profond dont chacun dénotera aussi un bel éloge de la liberté, un
appel à l’autonomie pour les dépossédés, et un indispensable combat en faveur
de l’émancipation des filles, abusées ou désabusées, des Philippines et
d’ailleurs. De cette brève lecture enchanteresse – l’éditeur nous assure, non
pas sans rire, qu’en 48 minutes top chrono l’affaire est dans le sac et la
nouvelle dans le cerveau (et dans le cœur plus encore) – on ressort empli
d’émotions, prêt à vivre ou à revivre. Rechargé en quelque sorte. Les batteries
pleines, on se bat mieux, c’est sûr. Vivre plus et mieux. Autrement aussi. Un
livre à mettre entre toutes les mains, surtout dans les écoles. Il est même
parfait pour les heures de colle car il nous apprend, aux professeurs et responsables
assermentés comme aux enfants sauvages et autres élèves collés, le juste prix
de la liberté et le bon sens des responsabilités non moins justes. En
n’oubliant jamais de se battre contre toute forme d’injustice : l’enfant
qui a la chance d’être scolarisé peut être collé avec ou sans raison, tout est
dans la bonne mesure, le juste milieu ou la voie médiane dirait-on plus à l’est
du monde. Mais la raison sans la passion n’a guère de raison d’être. Cette
nouvelle, extrêmement émouvante, est un fort bel exemple de « résilience »,
un terme à la mode pour une réalité qui ne l’est pas moins, et elle renvoie
précisément à la passion, en fait plutôt à une double passion, la seule qui
vaille à nos yeux comme je le suppose aussi à ceux de l’auteur : celle de
la vie et de l’amour. Faire quelque chose de sa vie plutôt que de résigner à la
subir vaut nettement mieux que tous les plans de carrière. Plutôt des projets
sur la comète que des plans d’ajustements trop structurels… « Je voulais être le père de quelque chose et
non le fils de quelqu’un », écrit quelque part Georges Bogey, voilà un
excellent sujet de dissertation pour une école du savoir, du gai savoir et
forcément buissonnière…
Franck Michel
mercredi 20 juin 2012
Inscription à :
Articles (Atom)